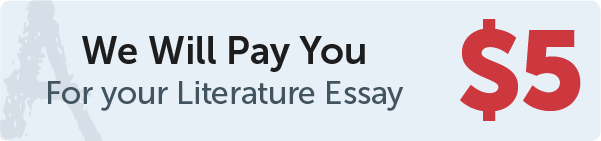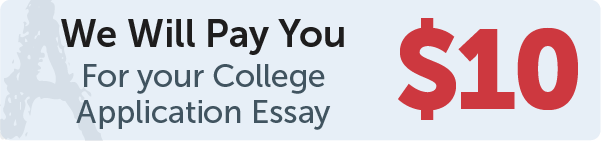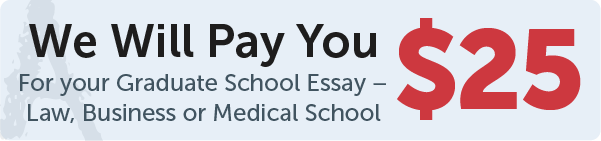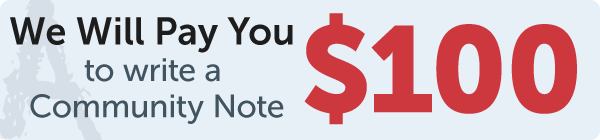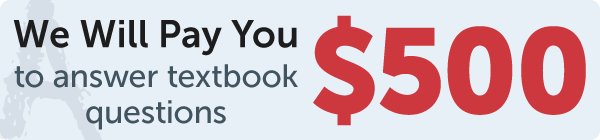Immédiatement après, Bérenger se rend chez son ami Jean. La porte est fermée et Jean ne lui répond pas car il est en train de dormir. Un autre homme nommé Jean, plus âgé, habite au même étage et sort sur le palier en entendant son nom. L’autre Jean finit par répondre.
Une fois à l'intérieur, Bérenger et Jean se rendent compte qu'ils ne reconnaissent pas la voix l’un de l’autre. Bérenger s'excuse pour son comportement de la veille, mais Jean ne semble pas savoir de quoi il parle. Il dit ne se souvenir ni de leur échange au café. Il se plaint d’une faiblesse passagère, d’avoir mal à la gorge et à la tête. Bérenger remarque qu’une bosse a poussé au-dessus du nez de Jean, qui dit s’être peut-être cogné en dormant. Au début, il ne voit même pas la bosse sur son front.
Jean se comporte de plus en plus bizarrement. Il devient agressif envers Bérenger et lui dit ne plus croire en leur amitié. Sa respiration devient de plus en plus lourde, sa voix de plus en plus rauque. De plus, son attitude change radicalement. Alors qu'il s’est toujours beaucoup soucié d’autrui, il n’accorde plus aucune importance aux êtres humains (" L’humanisme est périmé ! ”), ni aux valeurs morales (" La nature a ses lois. La morale est antinaturelle ").
Bérenger raconte à Jean ce qui est arrivé à M. Bœuf. La peau de Jean devient verte, rugueuse, et la bosse sur sa tête ne cesse de grossir. Jean manifeste de plus en plus de sympathie envers les rhinocéros, allant jusqu’à dire que le fait d’en devenir un n’est pas forcément quelque chose de négatif, puis se transforme lui-même en pachyderme.
Terrorisé, Bérenger cherche de l’aide auprès de Jean, le voisin. Jean et sa femme ne comprennent pas ce qu’il essaie de leur dire, et se transforment également en rhinocéros. Partout où Bérenger regarde, il voit des rhinocéros. Par la fenêtre, il voit des troupeaux de rhinocéros galoper dans la rue. Il s’enfuit en criant " Rhinocéros ! Rhinocéros ! ”.
Analyse
Cette scène, bien qu'elle soit brève, revêt une importance capitale. Elle débute par un événement perturbant : Bérenger et Jean ne parviennent pas à reconnaître leur voix, alors qu’ils ont l’habitude de se voir. Il est également étrange que Jean ne se souvienne pas des incidents impliquant les rhinocéros. C’est surtout ironique, et cela permet au lecteur de se mettre à la place de Bérenger, qui connaît la vérité. Dès le début de la scène, il est évident que Jean est en train de se transformer en rhinocéros.
En faisant se transformer en rhinocéros tous les personnages sous les yeux de Bérenger, Ionesco rend tangible la métaphore suis sous-tend la pièce. Jean se métamorphose en rhinocéros lorsqu'il perd tout intérêt pour les hommes et la condition humaine. Sa transformation s'accélère au moment où l’idée de devenir un rhinocéros ne le choque plus. Il devient indifférent à l’idée de devenir un rhinocéros (" Je n’ai pas vos préjugés ”). Les voisins, quant à eux, se muent en rhinocéros lorsqu'ils critiquent la réaction de Bérenger (" En voilà des manières !”). Ceux qui perdent leur empathie envers l'humanité, leur sens de l’écoute, deviennent tout simplement des animaux incapables de penser. Au fur et à mesure que le nombre de rhinocéros augmente, il devient de plus en plus difficile de se souvenir de l’importance de la rationalité et de l’individualité. Cette scène suggère que cette transformation peut se produire facilement et rapidement. Cela effraie naturellement Bérenger, qui se sent bien seul.
Le rôle de Bérenger dans la métaphore de Ionesco devient plus clair, même si on se demande encore s’il est peut-être seulement un peu plus lent que les autres à se transformer. Sera-t-il le dernier être homme sur Terre ? Le public espère qu'il incarnera la raison et la résistance face au conformisme.
La dynamique d'opposition que Ionesco a établie dès le premier acte prend de l’ampleur. Initialement, Jean semblait être le plus compétent et organisé, tandis que Bérenger semblait un peu moins socialement adapté. Le spectateur avait donc probablement tendance à préférer Jean. Désormais, il ne lui reste plus que Bérenger, dont la singularité pourrait être la raison de sa survie. Comme plusieurs dramaturges de l'absurde, Ionesco prend plaisir à ne pas faire ce que l’on attend de lui. Il soulève ici soulève la question de savoir à qui nous pouvons vraiment faire confiance pour se distinguer et non suivre le troupeau.
Ionesco continue également d'utiliser l'humour pour maintenir un certain niveau de tension et d'amusement. Par exemple, le fait que le voisin de palier de Jean s’appelle aussi Jean donne lieu à une scène très drôle, qui suggère que les individus sont peut-être plus interchangeables qu’on ne l’imagine. Ici, théâtralité et humour vont de pair, car la pièce reflète ce que Ionesco pense de l’absurdité de la vie humaine.